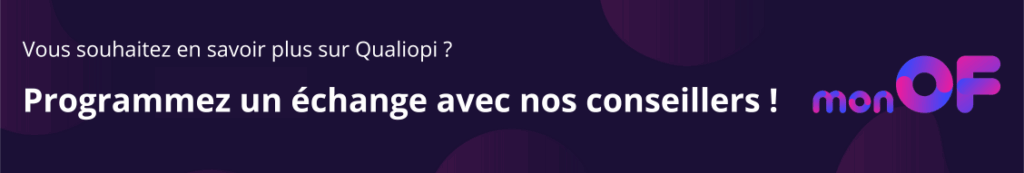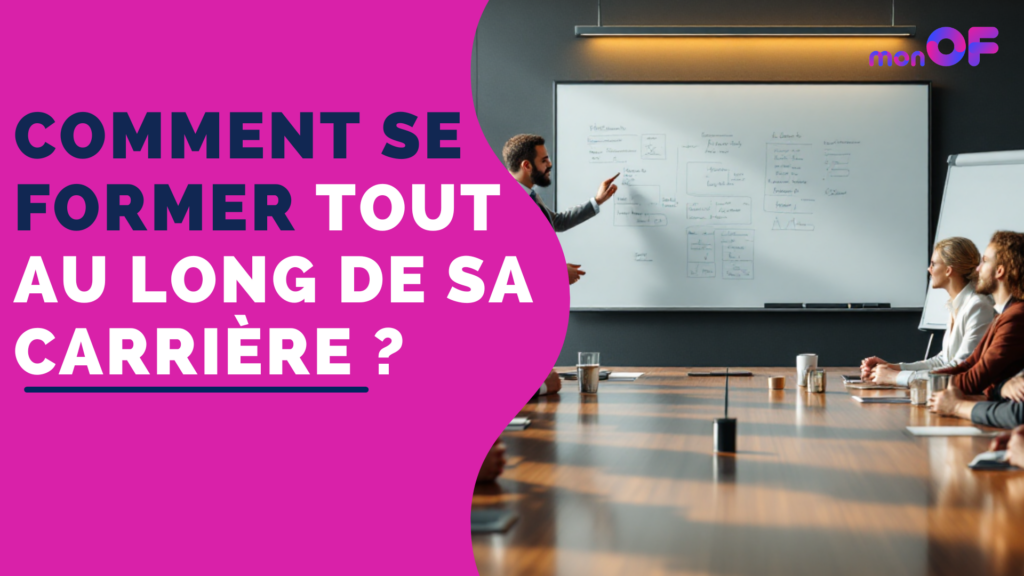L’indicateur 10 Qualiopi est souvent vécu comme très “terrain” par les organismes de formation. C’est lui qui oblige à prouver que vos parcours ne sont pas figés, mais réellement adaptés aux personnes que vous accompagnez. Derrière cet indicateur se joue donc une question simple : comment montrer, noir sur blanc, que votre prestation s’ajuste aux profils, aux contraintes et à l’évolution de chaque bénéficiaire, tout au long du parcours de formation ?
1. Que dit officiellement l’indicateur 10 Qualiopi ?
Dans le Référentiel national qualité, l’indicateur 10 appartient au critère 3, consacré à l’adaptation des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation aux publics bénéficiaires. Le texte officiel énonce que le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l’accompagnement et le suivi aux publics bénéficiaires.
La prestation doit être adaptée aux situations et aux profils des bénéficiaires, à la fois sur les contenus, les outils et méthodes, l’accompagnement, le suivi, la durée et les emplois du temps.
Point important pour vos équipes : le guide de lecture précise que, dans l’échantillon audité, le non-respect ( même partiel ) de cet indicateur entraîne une non-conformité majeure. Autrement dit, un seul parcours mal adapté ou non documenté peut suffire à faire tomber l’indicateur.
Cet indicateur est dit “commun” : il s’applique aux actions de formation, bilans de compétences, VAE et CFA.
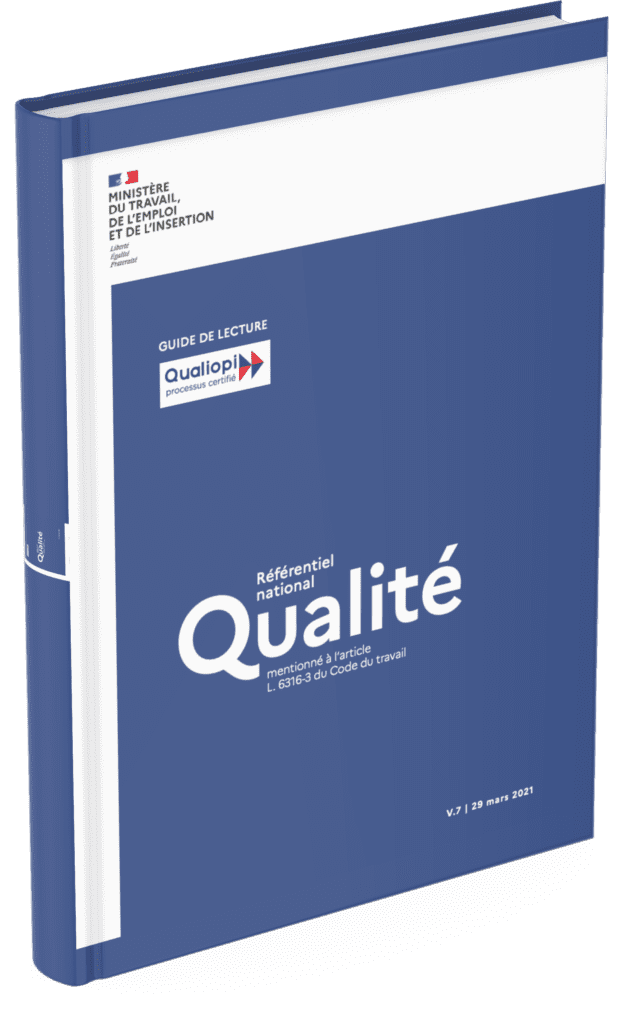
Consultez la dernière version du RNQ
Comprendre le RNQ est un prérequis indispensable pour réussir à obtenir Qualiopi. Téléchargez la dernière version du référentiel.
2. Adapter la prestation : bien plus qu’un ajustement de dernière minute
L’indicateur 10 ne se réduit pas à quelques aménagements ponctuels au fil de l’eau. Il s’inscrit dans une logique de parcours, en cohérence avec l’analyse du besoin (indicateur 8) et les conditions de déroulement de la prestation (indicateur 9).
Concrètement, il s’agit de montrer que la formation n’est pas “copier-coller” pour tous les publics. Plusieurs dimensions sont concernées : le rythme (plein temps, temps partiel, alternance, FOAD), la durée, les modalités pédagogiques (présentiel, distanciel, mixte), les supports (documents adaptés, outils numériques, ressources accessibles) et l’accompagnement (suivi individuel, points d’étape, médiation avec l’entreprise, etc.).
Cette adaptation doit également prendre en compte les situations particulières : publics en situation de handicap, bénéficiaires avec des contraintes de temps fortes, alternants dont la réalité en entreprise ne correspond pas exactement au référentiel du diplôme, etc. Le guide de lecture mentionne explicitement la nécessité d’aménager modalités, moyens techniques et humains pour les publics en situation de handicap.
3. Ce que l’auditeur va chercher à vérifier
Le jour de l’audit, l’auditeur va examiner des prestations réelles et regarder comment, pour un bénéficiaire donné, la prestation a été mise en œuvre et ajustée.
Le ministère du Travail donne des exemples de preuves très parlants : durées et contenus des prestations, emplois du temps, inscription aux modules en fonction du profil, constitution de groupes de niveaux, existence d’un référent pédagogique, livret de suivi pédagogique, séquences de médiation, traçabilité de l’accompagnement technique et pédagogique.
L’accent est également mis sur la cohérence entre l’ensemble des éléments qui composent le parcours : les déroulés pédagogiques, les modalités d’évaluation, le livret d’accueil, le règlement intérieur ou encore les informations relatives à l’accessibilité, notamment en FOAD et pour les publics en situation de handicap. Tous ces supports doivent raconter la même histoire : celle d’une prestation réellement ajustée au bénéficiaire.
Pour les CFA, une attention particulière est portée aux obligations prévues à l’article L.6231-2 du Code du travail : accompagnement dans la recherche d’employeur, suivi du contrat d’apprentissage et participation à l’évaluation et à l’adaptation de la formation.
4. Structurer sa démarche pour sécuriser l’indicateur 10
Pour un organisme de formation, l’enjeu est de passer d’une adaptation “intuitive” à une adaptation structurée et traçable.
D’abord, il faut formaliser un processus d’adaptation. Il ne s’agit pas forcément d’une procédure longue, mais d’un document qui décrit comment les besoins individuels sont identifiés en début de parcours (positionnement, entretien, diagnostic) puis traduits en aménagements concrets : ajustement de la durée, modules optionnels ou complémentaires, temps de tutorat renforcé, etc.
Ensuite, prévoir des temps réguliers de revue de parcours. De nombreux retours d’expérience montrent l’intérêt de bilans intermédiaires, de réunions de suivi, de journaux de bord ou de livrets de suivi partagés entre formateur, bénéficiaire et, le cas échéant, tuteur en entreprise.
Enfin, donner un rôle clair aux différents acteurs : référent pédagogique pour la coordination du parcours, formateurs pour l’adaptation des supports et des modalités d’animation, équipe administrative pour la mise à jour des conventions, avenants, plannings et convocations lorsque la prestation est ajustée.
5. Erreurs fréquentes et points de vigilance
Sur le terrain, plusieurs écueils reviennent régulièrement lors des audits.
Le premier, c’est la prestation “standard” proposée à tous, quel que soit le public. Le programme est identique, les durées ne bougent pas, les modalités restent les mêmes, alors même que les profils sont très différents. Dans ce cas, l’auditeur conclut que l’adaptation est insuffisante ou purement déclarative.
Le second écueil, c’est l’absence de trace. Beaucoup de formateurs adaptent spontanément leur pédagogie : ils ralentissent le rythme, proposent des exercices supplémentaires, aménagent les supports… mais rien n’est conservé dans le dossier du stagiaire ou dans les outils internes. Or, le référentiel insiste bien sur la nécessité de pouvoir démontrer et matérialiser les adaptations via des outils et supports.
Enfin, certains organismes réservent l’idée d’“adaptation” aux seules situations de handicap. C’est bien sûr un volet important, mais l’indicateur 10 vise l’ensemble des publics : demandeurs d’emploi, salariés, alternants, personnes en reconversion, etc.
Limiter l’adaptation à quelques cas particuliers expose à une non-conformité majeure.
6. Indicateur 10 et RNQ V10 : un enjeu appelé à se renforcer
À la date de fin novembre 2025, aucune version officielle du RNQ V10 n’est encore publiée, mais plusieurs analyses laissent entendre que les exigences en matière de transparence, de suivi et d’adaptation des parcours pourraient être renforcées.
Pour les organismes de formation, anticiper ces évolutions ne consiste pas à multiplier les documents, mais à consolider une logique déjà au cœur de l’indicateur 10 : montrer que l’apprenant n’est pas “noyé” dans un dispositif standard, mais qu’il bénéficie d’un parcours pensé, accompagné et réajusté en fonction de sa situation. En pratique, une bonne maîtrise de l’indicateur 10 aujourd’hui facilitera l’appropriation du futur référentiel demain.
Conclusion
Vu de loin, l’indicateur 10 peut faire peur : non-conformité majeure, exigence d’adaptation permanente, traçabilité fine… En réalité, il traduit simplement une attente forte de la politique publique de formation : que les parcours soient réellement centrés sur les bénéficiaires, et pas uniquement sur une offre catalogue.
En travaillant vos outils de positionnement, vos livrets de suivi, vos modalités de bilan intermédiaire et la coordination entre formateurs et équipes administratives, vous renforcez à la fois votre conformité à Qualiopi et la qualité perçue de vos prestations. Autrement dit, bien travailler l’indicateur 10, c’est à la fois sécuriser votre audit et améliorer l’expérience de vos publics, ce qui est précisément la vocation de MonOF.pro : aider les organismes de formation à concilier exigences réglementaires et pratiques opérationnelles utiles au quotidien.